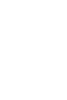On parlera beaucoup de Guillaume Morissette dans les années à venir. Jeune prodige de la littérature sur le web, Morissette est le premier à avoir véritablement fait le saut. Voilà, il faut le dire, Morissette est un Québécois francophone qui écrit en anglais (New Tab, Véhicule Press, 2014), et roule sa bosse jusqu’à Brooklyn. Un cas qui polarisera certainement le monde littéraire, comme le font si bien les œuvres de ceux qui osent, ceux qui sont naturellement hors-norme. Il n’y a aucun doute, l’écriture romanesque est sa vocation et il nous propose ici un texte, son premier traduit en français, sa langue maternelle, dans lequel il raconte d’où provient l’héritage culturel qui l’a mené à écrire dans la langue du général Wolfe.
L’anglais, une langue seconde où vivre ses crises d’angoisse
 Par Guillaume Morissette Traduction : Laurence Gough
Par Guillaume Morissette Traduction : Laurence Gough
J’ai grandi peu avant l’avènement d’internet, dans une ville tranquille et francophone de taille moyenne, à 200 kilomètres au nord de Québec. Ma ville natale compte une usine d’aluminium, plus ou moins une rue avec des bars, et si je ne me trompe pas, le premier Walmart à avoir fait une tentative de syndicalisation, qui s’est d’ailleurs soldée par la fermeture du magasin.
Comme mes parents ne parlaient que le français, mon premier contact avec l’anglais s’est fait auprès des jeux vidéo auxquels nous jouions, mes deux grandes sœurs et moi, en nous passant les manettes. Nous ignorions les textes, que nous ne comprenions pas, pour nous concentrer sur l’histoire, que nous avions inventée. Nous ne savions pas que « Bros » voulait dire « Brothers » et déduisions donc que le nom de famille de Mario, le personnage principal, était « Bros. » Puisque « Bros » ressemblait à « brosse » et que « brosse » était synonyme de « soûlerie », nous élaborions des théories compliquées selon lesquelles Mario était en fait un alcoolique en voie de rémission — théories qui n’ont jamais cadré avec le jeu.
À l’époque, l’anglais me faisait l’effet d’être une langue imaginaire. À l’école on nous l’enseignait une heure par semaine, mais comme notre entourage s’exprimait en français, il n’était pas moins étrange de savoir parler l’anglais que, disons, savoir baratter le beurre à la main. À la maison, aucun de nos postes de télévision n’avait le câble. Ils étaient plutôt alimentés par une espèce d’antenne en métal qui captait quatre chaînes en français, une chaîne en anglais. La seule chaîne de télévision anglophone à laquelle nous avions accès était CBC, un poste que je trouvais cauchemardesque comparé aux quatre autres. À ce poste cauchemardesque, les émissions sportives les plus banales, comme le curling ou la course à relais, se transformaient en un ramassis pas regardable de commentaires extra-terrestres et de plans d’athlètes en sueur.
Socialement, je ne cadrais pas, je n’avais pas beaucoup d’amis, et la raison de cette exclusion m’échappait. J’allais à l’école, étais confronté aux échecs ou au rejet, rentrais chez moi, pleurais parfois un peu, puis regardais les rediffusions des Simpsons en français pour me remonter le moral. En moi-même, je me disais : « Bart Simpson. » Je me disais : « Porter ta casquette à l’envers. » Je me disais : « Si t’as un skateboard, t’es cool. T’es populaire. » La plupart du temps, ils rediffusaient des épisodes que j’avais déjà écoutés, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans le fait de revoir les mêmes blagues se rejouer dans le même ordre, comme s’il s’agissait d’une rupture dans le continuum espace-temps. Les rediffusions me procuraient une stabilité précieuse, à une époque de ma vie où ma croissance ne semblait pas vouloir s’arrêter, où de jour en jour, je devenais sans cesse plus grand, plus rapide, plus sage.
Un jour, sans préavis, le poste qui diffusait l’adaptation québécoise des Simpsons a arrêté de le faire. Je me suis senti floué, incapable de comprendre la raison d’une telle décision. À mes yeux, quelqu’un, quelque part, avait mis fin à la meilleure émission de télévision des cinq chaînes confondues. « Comment tu peux canceller les Simpsons ? » me suis-je demandé. « C’est un peu comme retirer ton meilleur joueur parce qu’il frappe trop de courts circuits pis aller le faire attendre dans le char, ou de quoi de même. »
Les mois ont passé. Éventuellement, j’ai découvert par hasard que CBC, la chaîne télé cauchemardesque, avait ajouté à sa programmation de tous nouveaux épisodes, et pas des rediffusions, des Simpsons en anglais. Quand j’ai réalisé qu’après tout, même si la langue n’était pas la bonne, j’avais encore accès aux Simpsons, j’ai tout de suite eu le vif désir de me remettre à ma routine. J’ai commencé à regarder mon émission préférée en anglais. Au début, j’avais du mal à comprendre la suite d’événements qui composait chaque épisode, mais j’ai tenu bon. Je me disais : « The Simpsons. » Je me disais : « Il faut que je m’achète un skateboard. » Bart Simpson, un désastreux contre-exemple académique, m’a servi de moniteur d’anglais. Avec le temps, les épisodes ont peu à peu trouvé un sens ; à l’école, dans le cours d’anglais, je suis passé d’élève moyen à premier de classe en l’espace d’un an. Un après-midi, notre professeur m’a même félicité devant tout le groupe, l’air impressionné de ses propres aptitudes en enseignement.
J’ai par la suite ajouté à mon régime télévisuel anglophone les rediffusions de l’émission The Fresh Prince Of Bel-Air — une nouveauté dans ma vie. Quand j’y repense, il y a quelque chose de magnifique ou de complètement cinglé dans le fait d’avoir essayé, à neuf ou dix ans, de m’identifier aux aventures télévisuelles d’une famille afro-américaine qui habite en Californie, quand, du creux de ma ville glaciale, j’ignorais tout de ce qui n’appartenait pas à la culture québécoise.
Mes sœurs ont fini par perdre leur intérêt pour les jeux vidéo. Pas moi. En me servant de mes nouvelles habiletés en anglais comme d’une sorte de tremplin, j’ai développé une obsession pour les jeux de rôles japonais traduits en anglais. Leurs intrigues étaient sinueuses et bardées de textes qui parlaient du mal absolu, de mages noirs, de cristaux ultimes, de choses qu’enfin, je comprenais. Je me disais : « Une lame de légende. » Je me disais : « Un coffre aux trésors. » Je me disais : « Piégé par un gobelin rouge commun et sa bande de gobelins dans une forêt obscure. » L’anglais que m’avaient transmis Bart Simpson, Will Smith et la famille d’adoption de Will Smith avait réussi, d’une manière ou d’une autre, à faire son chemin jusque dans ces nouvelles contrées.
Au cœur des jeux vidéo, j’ai arpenté des territoires démesurés, découvert des cavernes hostiles, été mêlé tous les deux pas à des batailles difficiles contre des dragons et différentes sortes de créatures fantastiques. Je trouvais que les jeux de rôles japonais reproduisaient à merveille la sensation de vivre dans un univers dont les personnages te détestent et veulent ta mort.
L’école m’a exposé assez tôt aux auteurs français (notamment à Baudelaire, à Guy de Maupassant, à Molière et à Boris Vian), mais sur le coup, je n’ai pas réussi à m’y intéresser. L’attrait pour la lecture et la littérature ne se sont développés que plus tard dans ma vie. Les jeux vidéo de rôles et leurs histoires épiques, à la limite du mélodrame, s’avéraient être le seul environnement où je pouvais réfléchir à l’existence humaine en étant extirpé de ma petite personne merdique, où je pouvais penser en termes de mortalité, de moralité, d’amour, de relations, de valeurs, ainsi de suite.
À un certain point, mes parents ont dû se lasser de la parentalité. Parce qu’ils ont été moins présents avec moi qu’ils ne l’ont été avec mes sœurs et n’ont que vaguement supervisé mes études. Je trouvais ça correct, mais pas idéal. Ça ne leur dérangeait pas de voir leur fils effacé jouer tout le temps aux jeux vidéo. Ce qui leur a échappé, je crois, c’est que mon imagination était en train de se tourner vers l’intérieur et que je m’enfonçais de plus en plus creux en moi-même, dans une sorte de recherche spéléologique. Le jour, à l’école, je tombais souvent dans la lune. Je pensais au jeu vidéo qui m’occupait à ce moment-là, essayais d’anticiper la suite de l’histoire. Quand, plus tard, l’intrigue divergeait de la trajectoire que je lui avais imaginée, j’étais déçu, comme s’il s’agissait d’une petite trahison.
Bien des choses se sont passées dans ma vie en 1995. Le Québec a tenu le deuxième référendum de son histoire pour demander aux électeurs s’ils voulaient que la province devienne un État souverain, indépendant du reste du Canada. Plusieurs excellents jeux de rôles japonais ont fait leur entrée en Amérique du Nord, y compris Chrono Trigger, Breath of Fire II, EarthBound, Ogre Battle, et Lufia II : Rise of the Sinistrals. Mes parents ont finalement fait brancher le câble.
J’avais 11 ans, un parcours relativement enviable, toujours pas d’amis mais plusieurs jeux vidéo auxquels me consacrer.
Mes sœurs et moi ne nous intéressions pas à la politique, sauf pour ce qui était du référendum. Quand nous demandions à nos parents s’ils avaient l’intention de voter oui ou non, ils nous disaient : « On ne peut pas vous répondre. » En règle générale, mes parents évitaient de discuter de politique à la maison et même du parti pour lequel ils comptaient voter, de peur que nos opinions futures ne se calquent trop sur les leurs. J’ai cru pendant un certain temps que tout le monde fonctionnait comme ça, que pour une raison ou une autre, il n’était pas socialement acceptable de révéler le parti pour lequel vous alliez voter. Je ne comprenais pas très bien comment les sondages marchaient. Je me demandais : « Est-ce qu’on a le droit de dire aux sondages pour qui on veut voter, mais pas au reste du monde ? »
À mon sens, le référendum proposait de choisir entre « un changement excitant » et « aucun changement ». Je ne voyais pas trop pourquoi quiconque aurait voté non. Bien que je n’aie pas eu l’âge de voter, j’étais assez vieux pour comprendre que l’enjeu était de taille. En gros, je ressentais une espèce d’impuissance à l’égard du vote, et il me semblait étrange de n’avoir aucun contrôle sur une décision qui affecterait probablement autant ma vie que celle de mes parents.
Si l’intrigue de plusieurs jeux de rôles japonais auxquels j’ai joué cette année-là s’est gravée dans ma mémoire (Maxim et Selan meurent en héros à la fin de Lufia II, c’est triste), je ne garde aucun souvenir précis de la campagne qui a mené au vote. Ce dont je me souviens, par contre, c’est des coups de fil que recevaient mes parents de la part de Canadiens habitant dans les autres provinces. Ils appelaient les Québécois pour essayer de les convaincre de voter non, une tactique qui s’est sûrement avérée plus irritante qu’efficace.
Le soir du vote, mes parents ont regardé la soirée référendaire à la télé. Ils n’ont pas eu l’air particulièrement déçus ni heureux d’apprendre que le non l’avait emporté de peu. C’était peut-être encore un moyen de nous cacher, à mes sœurs et à moi, pour quel camp ils avaient voté : dissimuler leurs émotions, comme au poker. À ce jour, j’ignore encore qui a eu leur vote, mais je ne serais pas surpris que ce soit le oui. Wikipédia m’informe que notre circonscription comptait l’une des concentrations les plus élevées de oui dans la province, avec environ 75 % de voix en faveur de la souveraineté du Québec.
Après le référendum, je suis devenu — et suis probablement resté — un adolescent mésadapté, à l’amour-propre fluctuant, enclin aux crises d’angoisse. Je n’étais pas du genre à me fixer des objectifs, pas du genre entrepreneur, ni charmant, ni séduisant, ni fin causeur ; ma dextérité et ma coordination oculomanuelle se situaient en deçà de la moyenne, ce qui me rendait plutôt ordinaire dans les sports, la musique et les arts visuels.
J’avais assez d’acné pour miner ma confiance en moi, zéro connaissance de la mode et un groupe d’amis aussi mésadaptés que je l’étais.
Au secondaire, mes amis mésadaptés et moi n’avons pas une seule fois discuté de relations, de nos buts dans la vie ou de notre façon de percevoir le monde. Au lieu de ça, nous avons blagué, sans arrêt, comme pour essayer d’oublier notre médiocrité. Nous aimions l’humour absurde et décalé. Notre imagination allait trop loin. Je ne savais pas quoi faire de ma vie, mais ne savais pas davantage comment m’arrêter pour y penser. À l’époque, le mot « carrière » me faisait angoisser ou m’imaginer que je me ramasserais derrière le comptoir du club vidéo du coin. Je me ferais engager après le secondaire et passerais tout mon temps à jouer gratuitement aux jeux vidéo. Éventuellement, je deviendrais gérant. On me donnerait un polo d’une autre couleur que ceux des autres employés. Je porterais peut-être ma casquette à l’envers, et me rendrais au travail en skateboard.
Le Québec n’était pas un pays, mais je ne me voyais pas pour autant le quitter pour aller m’installer ailleurs au Canada. Le plus loin que je m’imaginais aller, c’était à Montréal. Mais à vrai dire, Montréal m’intimidait secrètement. À la télévision, on nous dépeignait cette agglomération comme une ville d’extrêmes, comme une ville de meurtres, de crimes, de manifestations citoyennes, de drogues, de gangs de motards, de tapis rouges, de groupes de musique populaires. Un endroit aussi cool que terrifiant.
Après le secondaire, j’ai quitté ma ville natale pour aller m’installer à Québec, une option moins effrayante que Montréal. Je suis devenu un adulte en proie aux troubles anxieux. Je ne me suis jamais acheté de skateboard, n’ai jamais été gérant dans un club vidéo. J’écoutais rarement les Simpsons, mais si, par hasard, je tombais sur un épisode à la télévision, c’était désormais à Homer que je m’identifiais, et plus tellement à Bart. Un jour, après avoir grossièrement menti en entrevue, j’ai été engagé par un studio de conception de petits jeux pour navigateurs web. J’avais toujours voulu travailler dans les jeux vidéo mais ma piètre confiance en moi me retenait de croire que ça se produirait. Finalement, je me suis senti à ma place dès le départ, et comme au beau milieu d’un fantasme.
Notre studio fonctionnait en français à l’interne mais la plupart de nos clients parlaient anglais. Mes habiletés avec la langue se sont donc vite révélées utiles. Je pouvais aider au design d’un document, rédiger des instructions de jeux et envoyer des courriels à nos clients. En travaillant dans l’industrie des jeux vidéo, je me suis bâti une solide confiance en moi et me suis prouvé que je valais quelque chose dans les sphères du design et de la création. Avec le temps, ma personnalité s’est mise à changer ; la conception de petits jeux pour navigateurs a commencé à moins me satisfaire. Comme il ne se passait pas grand-chose à l’extérieur de ma vie professionnelle, j’avais besoin de projets déterminants au travail, besoin de m’accomplir sur le plan artistique, pas juste de ramasser un chèque de paye. J’avais envie de plancher sur un jeu pour les grosses consoles : un jeu comme ceux dont ils parlaient sur les sites internet que je visitais chaque jour. Le genre de jeu dont la sortie serait annoncée en conférence de presse dans le cadre d’un important congrès de jeux vidéo.
J’ai commencé à déprimer.
Je me disais : « Il n’y a aucun espoir nulle part. »
Ma relation avec les jeux vidéo s’est imprégnée de mélancolie. Les jeux perdaient de leur lustre, de leur sens. J’avais arrêté de sauter sur des choses ou de classer des pierres précieuses ou de participer à des courses de voitures effrénées : dorénavant, je sautais vainement sur des choses, classais vainement des pierres précieuses, participais vainement à des courses de voitures effrénées. Je tirais de moins en moins de plaisir des jeux auxquels je jouais, jusqu’à ce qu’un jour, je m’en désintéresse complètement. Jusque-là, mon identité s’était en quelque sorte construite autour des jeux vidéo. Il me semblait que les extraire de ma vie revenait à retirer la balle d’une partie de Pong pour laisser les deux raquettes s’agiter de haut en bas sans aucune raison.
Pour ce qui était de ma dépression, je sentais que les jeux vidéo ne m’apportaient plus la part de sagesse dont j’avais besoin. Un des jeux disait : « Tire des hommes armés en pleine face. » Un autre : « Bats-toi contre des monstres fantastiques, mais genre, stratégiquement. » « Mais j’ai mal, que je me disais. Je suis comme en crise. Au lieu de me dire de tuer des monstres, tu pourrais pas me donner des conseils existentiels ou de quoi ? Il faudrait que je me sente comme un dieu de la guerre, mais c’est pas le cas. »
Je trouvais étrange que le médium duquel je m’étais senti le plus proche dans ma vie ne parvienne plus à me réconforter et me traite comme quelqu’un de « bizarre ».
J’ai essayé d’obtenir de l’aide de ma famille, mais le mieux qu’ils ont pu faire équivalait à mettre un pansement adhésif sur une opération à cœur ouvert. Nous menions nos vies d’adultes chacun de notre côté, dans des directions différentes : mes parents se dirigeaient vers la retraite, ma plus grande sœur, vers une carrière de musicienne à Québec, mon autre sœur, vers la fondation d’une famille. À la fin de 2008, mes parents, mes sœurs et moi nous sommes retrouvés pour Noël, une réunion qui s’est terminée dans les cris et les claquements de portes. Par la suite, notre situation familiale s’est détériorée et nous avons pris le parti de faire nos affaires chacun dans notre coin.
J’ai déménagé à Montréal pour fuir ma dépression et m’ouvrir à d’autres opportunités. J’ai eu beau me dire que ça avait fonctionné, que je m’étais « guéri » de ma dépression, le soulagement que m’avait procuré le déménagement a été de courte durée, comme s’il s’était agi d’une espèce d’Aspirine spirituelle. La dépression est revenue. Au moins, à Montréal, j’avais plus facilement accès aux librairies anglophones, et c’est à leur contact que je me suis mis à m’intéresser à la littérature contemporaine. J’ai commencé à acheter des livres au hasard, à suivre des auteurs en ligne, à lire comme un perdu. Pendant ma première année à Montréal, j’ai lu du Miranda July, du Ann Beattie, du Lorrie Moore, du Tao Lin et plusieurs autres auteurs. J’ai trouvé dans leurs écrits des conseils qui m’ont aidé à mieux me comprendre et à vivre ma vie.
Là où je travaillais, à Montréal, nous fonctionnions presque exclusivement en anglais. Ça ne posait pas de problème. J’ai commencé à me faire des amis dans la communauté anglophone et à sentir que j’avais peut-être plus de choses en commun avec eux qu’avec mes colocataires francophones. Ce passage à l’anglais a eu sur moi l’effet d’un nouveau départ : c’était comme le fait de déposer mon identité sur une table à dessin et de me permettre de gribouiller.
Au bout d’un certain temps, j’ai compris que si je voulais me débarrasser complètement de la dépression, il fallait que je mette le feu à ma vie. Je me rappelle avoir annoncé à ma mère, avec qui je parlais au téléphone à tous les quelques mois, que je retournais à l’école à temps partiel. Elle ne comprenait pas ma décision de m’inscrire au programme Creative Writing à Concordia plutôt qu’en création littéraire à l’UQAM. Ça la dépassait. Il m’est venu à l’esprit que je m’étais peut-être aventuré trop loin dans l’anglais, que la voie sur laquelle je m’engageais, vers l’extérieur du Québec et en direction du reste de l’Amérique du Nord, m’aliénerait encore davantage ma famille. À l’avenir, une partie de moi leur resterait inaccessible, aussi extra-terrestre que l’avait été pour moi la chaîne de télévision cauchemardesque de mon enfance.
Je ne m’imagine pas ce que serait ma vie aujourd’hui si le Québec avait voté oui au référendum de 1995 et s’était bel et bien séparé des autres provinces. Ma famille et moi serions peut-être restés proches. Nous aurions peut-être trouvé d’autres raisons de nous éloigner. Le visage de la communauté anglophone de Montréal serait tout autre, puisqu’il serait rendu plus compliqué pour les Canadiens du type créateur de venir s’installer ici. Montréal ne serait sûrement pas devenue le berceau d’artistes comme Grimes, Sean Michaels ou Majical Cloudz, pour n’en nommer que quelques-uns. Je n’aurais même pas rencontré ma copine, avec qui je suis en couple depuis deux ans, et qui a quitté son Terre-Neuve d’origine en 2010.
La décision qu’a prise le Québec de voter non en 1995 m’a fait réaliser que la province était habitée d’une multitude de voix, et que ces voix étaient moins unies que je ne l’avais cru. À plusieurs égards, le non s’est avéré être une sorte de oui déguisé. Un oui adressé au Canada, un oui comme une permission donnée à ma vie de s’engager sur un chemin tortueux.
L’automne dernier, alors que je traversais les États-Unis pour participer à une série de lectures et d’événements de toutes sortes, j’ai remarqué quelque chose d’étrange. Plus je m’éloignais de ma ville natale, plus j’en parlais, surtout aux gens qui n’avaient qu’une vague idée de ce qui constituait la culture québécoise. Bizarrement, j’avais l’impression de transporter le Québec et l’éducation que j’avais reçue partout où j’allais, comme s’il était impossible de m’en défaire, même si je l’eus voulu.