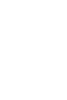Découvrez quatre villages québécois disparus par Julie Buchinger

Gagnon (1960-1985)
René Couacou, Haïtien d’origine, débarqua au Québec avec son épouse en 1962. Et c’est dans le Nord québécois qu’il atterrit, en plein hiver, à quelque quatre cents kilomètres au nord de Baie-Comeau. Il partit refaire sa vie dans le petit village de Gagnon.
Sur la Côte-Nord, aux abords du lac Jeannine, se trouvait un gisement de fer que la compagnie minière Québec-Cartier avait l’ambition d’exploiter. L’entreprise décida de fonder un village à proximité de la mine afin d’y loger ses travailleurs et leur famille. Le village, qui doit son nom au ministre des Mines et lieutenant-gouverneur du Québec de l’époque, Onésime Gagnon, vit donc le jour en 1960.
Les mineurs y trouvèrent leur compte : en effet, plusieurs d’entre eux jouissaient de meilleures conditions de travail que celles qu’ils pouvaient espérer près des grands centres. Gemma Poulin, qui était enseignante là-bas, se souvient des réveillons où toutes les familles du village se retrouvaient dans la salle communautaire pour déguster un repas de Noël d’une rare abondance : la compagnie, en plus d’offrir des cadeaux à tous les enfants, faisait venir par avion un service de traiteur de Sept-Îles qui préparait, pour les convives, des « arbres de Noël en homards ».
Mais c’est sans doute le grand esprit de solidarité et de fraternité qui régnait dans cet ancien patelin minier qui le distinguait des autres. René Couacou en témoigne : lorsque son épouse meurt, quelques années après leur arrivée à Gagnon, il est épaulé par les habitants qui l’encouragent à rester parmi eux. Soutenu par sa communauté, il sentira le désir de s’investir en politique municipale et occupera la mairie du village pendant treize années, jusqu’à sa fermeture définitive. En effet, Couacou se battra jusqu’à la fin pour sauver Gagnon lorsque la minière Québec-Cartier cessera ses activités dans le secteur en 1985. En vain, malheureusement.
Il ne subsiste, aujourd’hui, de Gagnon, qu’un seul panneau de signalisation qui servait à annoncer que le village se trouvait à cet endroit, et de tristes vestiges de la rue Numéro 1.
Pascalis (1938-1944)
Dans les années 1940, l’État payait ses pompiers vingt-cinq sous de l’heure. Il s’agissait d’un salaire décent – un écorceur gagnait, à l’époque, un dollar par jour dans une scierie. Mais les conditions de travail étaient pénibles pour les hommes appelés en renfort lors des incendies. Ils combattaient les flammes avec des haches, des pics et des pelles ; souvent, ils devaient transporter eux-mêmes l’eau, qu’ils puisaient dans les rivières à l’aide d’un sac à dos fait de caoutchouc. Les pompiers volontaires ne se bousculèrent donc pas au portillon lorsqu’un incendie de forêt menaça la petite ville de Pascalis, située dans la région abitibienne, en 1944.
Situé au nord-est de Val-d’Or, ce petit village fut créé de toutes pièces par le ministère des Mines du Québec en avril 1938 et compte, parmi ses habitants, les employés des mines de Perron, de Cournor et de Beaufor, desquelles on extrait de l’or et de l’argent. Pascalis fut séparé en cent trente-deux lots, qui trouvèrent rapidement preneurs. En plus des mineurs québécois, des travailleurs Ukrainiens, Polonais et Allemands firent la demande pour obtenir des parties de lots qui leur seraient propres afin de pouvoir se regrouper.
Au début du mois de juillet 1944, la forêt brûlait et Pascalis était entouré de foyers d’incendie. Le ciel était si sombre qu’on raconte que les poules rentraient au poulailler en plein jour. Alors que le maire demandait aux hommes de se mobiliser pour combattre le feu qui menaçait leur village, le curé, Gaspard Forest, au nom prémonitoire, invita les femmes et les enfants à adresser leurs prières au Ciel et à demander à Dieu qu’il pleuve.
Leurs pieuses demandes ne furent malheureusement pas exaucées : le sept juillet 1944, le feu détruisit tout le village en une heure et demie à peine, ne laissant intacte que la maison d’un certain Adrien Boulay, à l’extrême sud de l’agglomération rurale. La maison fut éventuellement déménagée à Colombière, mais l’histoire ne dit pas ce qu’il advint de M. Boulay, homme sans aucun doute béni des dieux.
Labrieville (1953-1974)
Dans une courte allocution prononcée alors qu’il recevait un doctorat honoris causa de l’UQAM, Gilles Vigneault remercia un certain monseigneur Labrie, qu’il connut au cours de ses jeunes années sur la Côte-Nord. À l’époque, Vigneault craignait de décevoir l’homme de foi en lui avouant candidement qu’il avait « très tôt entendu l’appel… de la race » et qu’il ne « saurai[t] devenir prêtre ». Monseigneur Labrie, loin de se laisser démonter par une telle révélation lui dit simplement : « Mon garçon, fais ce que tu voudras, mais fais quelque chose de ta vie. » C’était un homme inspiré.
Né à Godbout en 1893, Napoléon-Alexandre Labrie étudia chez les pères eudistes, sur la Côte-Nord, avant de se rendre en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et enfin à Rome, où il fut ordonné prêtre en 1922. Il fut ensuite nommé vicaire apostolique du Golfe Saint-Laurent en 1938, une région qui couvre le territoire compris entre les rivières Saguenay et Natashquan.
C’est en son honneur que fut nommé le village de Labrieville en 1953. Hydro-Québec avait jeté les fondations de ce village afin de loger les travailleurs qui participaient, à l’époque, à la construction des centrales Bersimis-1 et Bersimis-2, dans la région de la Haute-Côte-Nord. C’est Maurice Duplessis lui-même, alors premier ministre du Québec, qui vint prononcer le discours inaugural au cours duquel il vanta les vertus de monseigneur Labrie et qui nomma officiellement le village en son honneur. Monseigneur Labrie, en bon prince, déclara que l’église de Labrieville porterait le nom de Saint-Maurice.
Les centrales Bersimis furent construites et inaugurées en 1959, et les années 1960 furent difficiles pour les habitants de Labrieville, car on peinait à trouver un nouvel employeur majeur pour embaucher la main-d’œuvre locale. C’est le déclin ; Hydro-Québec dut démanteler la ville en 1974. Les maisons restantes furent déménagées ; quant à l’église Saint-Maurice, elle fut rasée.
Duplessis n’a plus son église et monseigneur Labrie a perdu son village. Mais heureusement pour notre patrimoine, Labrie nous aura légué, en partie, la voix de Gilles Vigneault.
Saint-Jean-Vianney (1930-1971)
Le soir du quatre mai 1971, les Canadiens de Montréal affrontaient les Blackhawks de Chicago. C’étaient les finales de la coupe Stanley et tout le Québec était absorbé par le match. Dans la municipalité de Saint-Jean-Vianney, sur la rive nord du Saguenay, ils étaient nombreux, ce soir-là, à rager contre leur téléviseur ou leur poste radio, lorsqu’une panne de courant interrompit la programmation.
Saint-Jean-Vianney était un petit hameau agricole et pittoresque au moment de sa fondation en 1930, mais connut une expansion considérable au cours des années 1950, lorsque plusieurs travailleurs des usines d’Alcan et d’Abitibi-Price vinrent s’y installer. Comme on manqua rapidement de terrain, on entreprit de construire en terrain marécageux.
« Si vous construisez là, vous allez ramasser les maisons dans le Saguenay », avait proclamé un citoyen sceptique à la mairie. Dans la nuit du quatre au cinq mai 1971, un prodigieux glissement de terrain emporta effectivement une quarantaine de maisons dans une énorme coulisse de boue, laissant un trou béant au beau milieu du village. On fit état de trente et un décès, en plus de sonner le glas de Saint-Jean-Vianney.
On dit souvent que ce funeste bilan aurait pu être bien pire si la majorité des citoyens, au lieu d’écouter la partie de hockey qui s’étirait en prolongation, avait été emportée par la boue dans son sommeil. C’est une bien maigre consolation pour les anciens résidents de Saint-Jean-Vianney, mais les Canadiens, faut-il le mentionner, gagnèrent la Coupe cette année-là.
Fort-George (1803-1981)
On retrouve, un peu au sud de l’affluent de la baie James et de la baie d’Hudon, une île du nom de Fort-George, anciennement nommée île des Gouverneurs. Située sur le territoire de la communauté crie, cette île était, au XIXe siècle, un poste de traite exploité par la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il s’agissait d’un lieu de transit important pour les autochtones et les coureurs des bois qui voyageaient le long de la côte de la baie James ou sur La Grande Rivière.
Fort-George doit son nom au trafiquant de fourrure et explorateur George Atkinson, né en 1777 à Eastmain House, premier poste de traite permanent instauré par la Compagnie de la Baie d’Hudson en 1723. Fils d’un père Anglais, lui-même employé par la Compagnie, et d’une mère cri, du nom de Necushin, il vécut d’abord une douzaine d’années sous le nom de Sneppy, avant d’être envoyé en Angleterre où on le baptisa du nom de son père.
Atkinson était impétueux et il mena une vie d’aventure au Canada, où il servait brillamment la Compagnie par son courage et sa grande connaissance des peuples autochtones. Son supérieur, lors d’une expédition qui visait à atteindre un poste de traite ennemi sur le lac Cheasquacheston, James Fogget, remarqua rapidement la préférence d’Atkinson pour ses compatriotes indiens et il s’en plaignait : « La compagnie des Indiens le ravit toujours, [mais] non celle des Anglais. » Ses expéditions ouvrirent néanmoins la voie du Labrador au commerce et assurèrent l’approvisionnement de fourrures par les Indiens à la Compagnie de la Baie d’Hudson pendant de nombreuses années.
Fort-George n’existe plus aujourd’hui. Le poste de traite est éventuellement devenu le village cri de Chisasibi, qui fut déménagé en 1981 sur la terre ferme, en vertu de l’accord de Chisasibi. Quant aux descendants de Georges junior, ils vivent sans doute toujours. En effet, Georges ne rompit jamais complètement avec le peuple cri ni avec ses traditions ; il épousa deux femmes issues de cette communauté, à la manière du pays, avec qui il eut quatorze enfants.